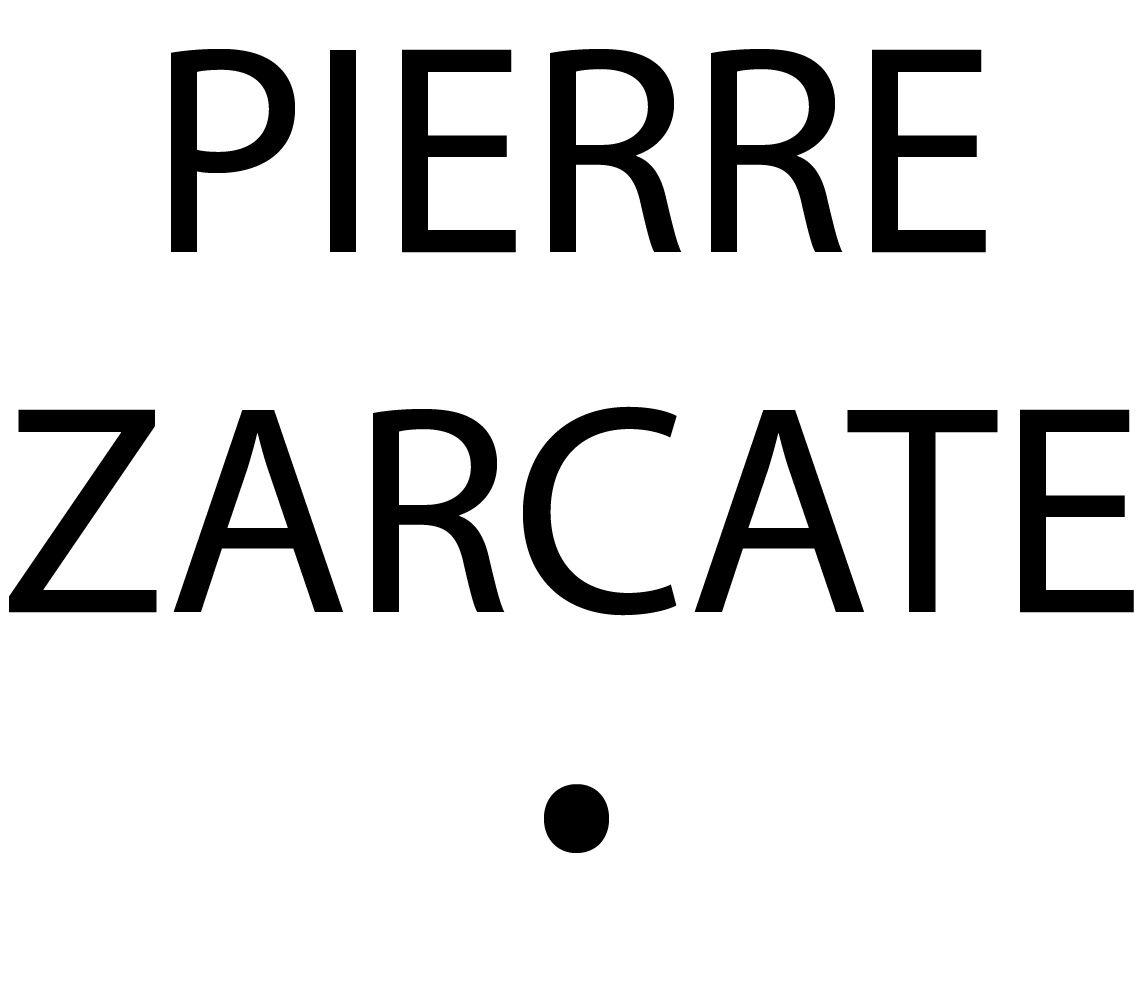Suite égyptienne
. 1989-1991
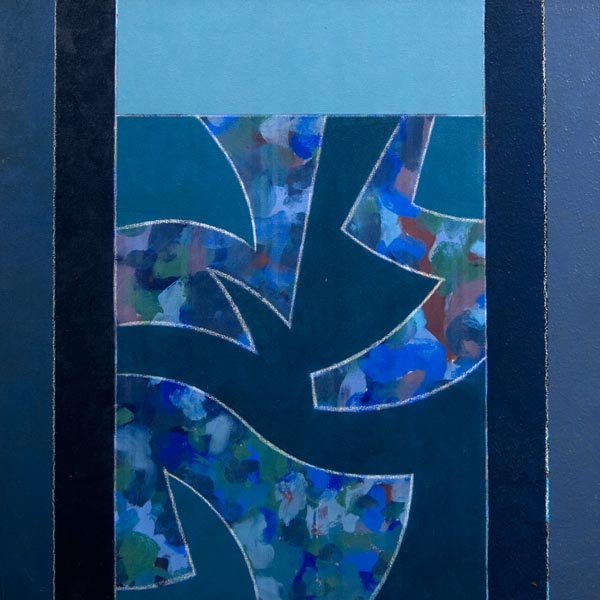
SE VII, 1989
Huile et pastel sur toile, 103 x 103 cm
« Résoudre un tableau est à quatre-vingt dix pour cent résoudre une équation colorée, en être conscient ou non, le reconnaître ou pas n’y change rien. (…)
Quelle que soit la volonté d’expression, le propos du tableau, son sujet, le langage de la peinture c’est la surface colorée. »



Archives de l’artiste
Je me suis livré ces derniers temps à une division de la surface des tableaux. Chaque partie est résolue dans une intention qui lui est particulière mais doit raisonner en accord avec l’ensemble. Or cet accord est souvent inattendu, ce n’est pas dans la logique qu’il se trouve, c’est dans l’improbable, dans le choquant, dans l’absurde, dans le gratuit bref dans l’invention. (…)
Ce n’est pas le tableau qui compte c’est l’écoulement régulier et comme photosensible de la pensée du peintre. Le morcellement récent de mes peintures me paraît un moyen d’enregistrer au jour le jour des pulsions différentes. (…)
Le sujet des tableaux, c’est la poursuite d’une mémoire de la peinture.
D’un fragment à l’autre le lien se fait uniquement par la sensation poétique. (…)

SE XIX, 1989
Huile sur toile,150 x 130 cm
SUITE ÉGYPTIENNE
Catherine Strasser
Catalogue de l’exposition «Suite égyptienne»
Galerie Lamaignere, Paris, 1991
L’ORIENT DU PEINTRE
La frise, de rose et d’or alternés, souligne deux carrés
rouge et orange et vient buter contre une bande verticale
de bleus chamarrés qui se souviendrait du ciel si elle
n’était surmontée d’un autre carré uniforme , d’un bleu
différent, différant encore de deux frises médianes qui
bordent, dans sa partie supérieure, une zone de terre
brune elle-même zébrée d’une forme orangée définie
par deux arabesques brisées : ses contours ne sont plus
blancs comme dans les parties gauche et supérieure de la
surface mais vibrent des bleus qui l’encadrent. La touche
varie mais la matière reste uniformément lisse sur la
totalité du XIXe tableau de la Suite égyptienne.
SE XIX expose, dans sa complexité, la recherche menée
par Pierre Zarcate, pendant plus d’un an, sur cet
ensemble de tableaux. Parce qu’elle s’annonce orientale,
il faut considérer cette Suite sous son angle oriental et
y voir le fruit d’une expérience directe, un voyage en
Egypte, mais aussi l’objet d’influences différées. Comme
peut l’être aujourd’hui le regard porté par l’artiste sur
ceux qui l’ont précédé.
Avant d’être un territoire physiquement éprouvé par les
peintres, l’orient est, au milieu du XIXe siècle, l’espace
imaginaire de la couleur et de la lumière bien plus qu’un
magasin d’accessoires exotiques.
L’orientalisme, dont Delacroix représente la figure
emblématique, n’est pas seulement une vogue explicable
Historiquement. Il confirme le peintre dans la volonté de
s’affranchir des codes d’utilisation de la couleur.
Dans l’écart qui existe entre la gamme chromatique
des Massacres de Scio (une Grèce fantasmée) et celle des
Femmes d’Alger (tirées d’une étude sur le motif) se situe
le passage de l’orient rêvé à l’orient vécu.
Cet affranchissement continuera de traverser l’art
moderne. Qu’il suffise de se rappeler Matisse au Maroc,
Klee s’exclamant après son séjour à Kairouan : « La
couleur et moi sommes un. Je suis peintre ». La révélation
d’une lumière qui fait apparaître les couleurs sous
un jour nouveau est relayée par l’emploi, proprement
oriental, de la couleur.
On songera ici à l’ancienne Egypte mais aussi aux
bigarrures des vases, étoffes et tapis. L’orient de Pierre
Zarcate, pour s’enrichir de la dimension du souvenir
biographique, rencontre l’histoire de la peinture.
l’antiquité, répondra notamment, dans l’art islamique, à
l’interdiction de l’image mimétique. Dès lors que l’effet
de surface se constitue du motif même qui s’y inscrit,
toute représentation – fût elle virtuelle – d’un objet ou
d’un corps dans l’espace est vouée à l’échec. Ou comment
tracer un signe sans représenter.
DES ACCORDS ABSTRAITS
Chaque geste n’existant qu’en tant que geste coloré, le
dessin et la couleur sont indéfectiblement liés. Les tons
se juxtaposent avec audace mais toujours guidés par
« l’harmonie » générale du tableau. Cette « harmonie »,
en conduisant la finalité de chaque objet dans le domaine
de la couleur, peut être rapprochée d’une recherche
musicale.
Dans l’histoire de la querelle esthétique qui oppose – dès
le XVIe siècle en Italie – les partisans du dessin et ceux de
la couleur, ce rapprochement apparaît un siècle plus tard
en France. Par la suite, la théorie de l’art s’interrogera
fréquemment sur ces rapports et c’est à la fin du XIXe
siècle, avec les débuts de la modernité, que ce parallèle
prendra toute sa consistance.
Poètes et peintres réunissent leurs recherches autour
des notions de musicalité et d’harmonie. La quête
d’harmonies nouvelles se double d’une fascination pour
le modèle abstrait que fournit la musique. Les premières
théories de l’abstraction s’y réfèrent continuellement.
Apollinaire appelant de ses voeux un art nouveau et
tentant de définir la peinture à venir évoque l’idée d’une
« peinture pure » qui serait « à la peinture ce que la
musique est à la littérature », pour conclure que cet art,
débutant, « n’est pas encore aussi abstrait qu’il devrait
l’être ».
Delaunay compare les couleurs aux notes musicales pour
introduire la notion de « mouvement de la couleur ». Le
travail de la couleur atteint dans l’art moderne un niveau
d’abstraction véritable. L’effet coloré naît davantage du
rapport des couleurs entre elles que du ton local. Matisse
en dit : « Les teintes les plus belles, les plus fixes, les
plus immatérielles s’obtiennent sans qu’elles soient
matériellement exprimées. »
L’idée de la suite, poursuivie par Pierre Zarcate dans
l’ensemble de tableaux présenté ici, consiste en une série
de variations qui s’apparentent à la recherche tenue
par l’altération d’un autre élément, en vue de l’effet
d’ensemble. Ces variations ne s’articulent pas autour
de thèmes mais d’accords, s’inscrivant en cela au coeur
de préoccupations contemporaines dans le domaine
de la composition. En cela, elle rend obsolète la notion
d’harmonie. La composition colorée, savante, se fonde
sur des accords traditionnellement considérés comme
inharmoniques. En abandonnant l’idée de thème central,
elle justifie la variété de ses moyens. Sur ce terrain encore
Cet orient pictural, indique la direction de la Suite
Egyptienne et la qualité de son éclat.
L’ESPACE DE LA COULEUR
Quel qu’en soit le format, chacun des tableaux est conçu
comme une entité autonome, ramassée à l’intérieur de ses
bords et close sur elle-même, respectant la loi du cadre
comme une fresque antique. L’espace y joue la planéité
absolue. C’est donc strictement dans la bi-dimensionnalité
que s’impose la qualité spatiale de la couleur.
Ce type de recherche qui a conduit Matisse à la
pratique des papiers découpés apparaît dès les débuts de
la modernité. Gauguin avance : « Je me charge de vous
rapetisser ou de vous agrandir le même dessin selon la
couleur avec laquelle je le remplirai » et trouve un écho
dans les cours que Klee prononce au Bauhaus, affirmant
que des triangles remplis de jaune ou de vert « sont des
êtres différents ». Transitant par Albers, ces expériences
détermineront un pan de la peinture américaine.
La gamme colorée, constituée de tons saturés mais
– à peine – rompus, régit l’unité formelle de la Suite
égyptienne. Elle dicte le choix de la touche, du dessin et de
la composition. A l’intérieur de chaque tableau se déploie
un éventail complexe de gestes picturaux. Peuvent
y voisiner le signe graphique, la tache, la géométrie
orthogonale et l’arabesque.
La composition résulte d’une partition de la surface en
zones traitées chacune selon une modalité particulière.
Ainsi un signe peut s’auréoler d’un halo, une bande unie
buter contre un dégradé de tons voisins, un contour
manger l’intérieur de la forme qu’il circonscrit, un trait
se transformer en touche, une bande border un puzzle de
taches préméditées, une nébuleuse naître de la géométrie
la plus stricte.
La combinaison des ces éléments est indéfiniment
variable. La tension qui en résulte concourt à l’équilibre de
la composition. A l’inverse d’une pratique démonstrative,
la variété des moyens n’est pas destinée à mettre en
exergue le faire du peintre mais elle correspond à
l’absolue nécessité d’avancer la couleur selon le mode le
plus efficace.
L’utilisation des frises géométriques, de bandes, de
carreaux s’approprie un vocabulaire moderne aisément
repérable. Avec l’arabesque ou le motif géométrique
répété en frise, la figure fait fond. Ce système, apparu dèset bien que certaines formes y restent allusives, elle
évacue la représentation et répond, par cette recherche
d’accords abstraits, à la question : que peindre ?EDONIDES
Parce qu’elle concentre ses enjeux autour de l’effet
sensible de la composition colorée, la Suite égyptienne
échappe à toute proposition idéaliste. On ne la situera ni
du côté de la fiction ni dans l’ironie métalangagière. Le
rapport direct, immédiat qu’elle engage à la perception
oblige le spectateur à approcher physiquement,
sensuellement le tableau. Il ne faudra pas, pour autant,
voir dans la démarche de Pierre Zarcate une conception
formaliste de la peinture. La couleur résiste au langage,
mais sans déplacer le sujet du peintre vers l’exercice ou la
démonstration. Il s’inscrit, profondément, au coeur d’un
des projets modernes, visant à remplacer le discours par
la picturalité même. Une conception hédoniste du monde
y garantit le pouvoir de l’imagination qui préside à
l’élaboration de la forme. Sa fin est la jubilation.