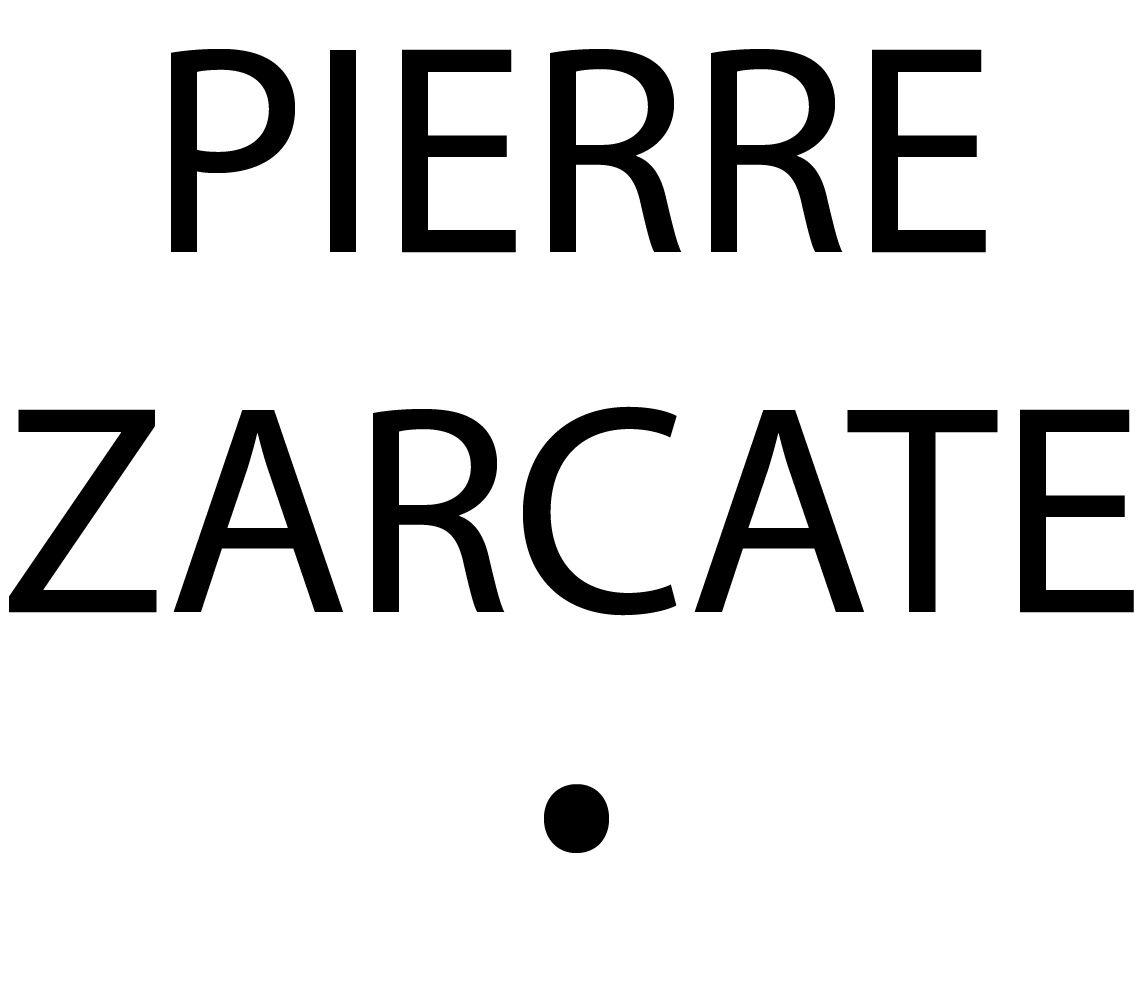Images Monde
. 2000-2009
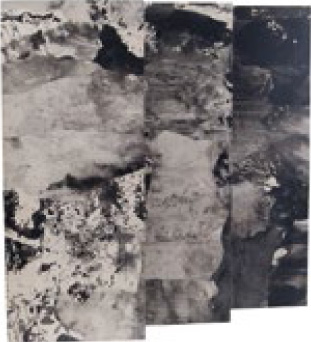
Encre de chine sur papier sur bois
100 x 100 x 26 cm
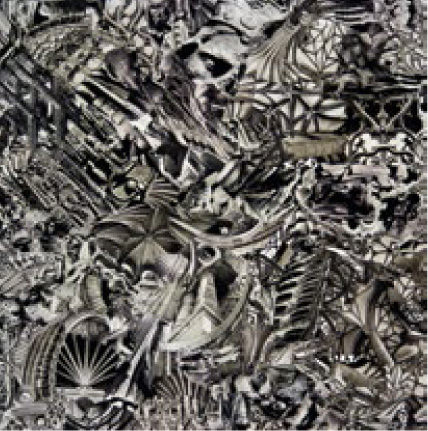
Éditions photographiques sur bois
120 x 120 cm

Rêve de fillette 1, 2004
Éditions photographiques sur papier cartonné
41 x 33 cm
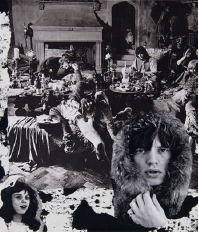
Vie de château, 2009
Éditions photographiques
et encre de chine sur papier cartonné
26 x 30 cm
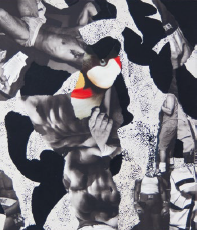
Vestiaire voyeur 1, 2007
Éditions photographiques
et encre de chine sur papier cartonné
26 x 30 cm

« Sur le modèle du sampling la
réutilisation des images existantes
n’est pas un obstacle à la
production d’un résultat neuf. (…)
Au contraire dans le cas des
images monde c’est la juxtaposition
imprévue des éléments qui recrée
une vision neuve. (…) »

Éditions photographiques sur bois
120 x 120 cm

Eau minérale, 2004
Éditions photographiques sur papier cartonné
41 x 33 cm
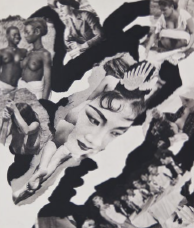
Cosmopolite, 2006
Éditions photographiques
et encre de chine sur papier cartonné
23 x 24 cm
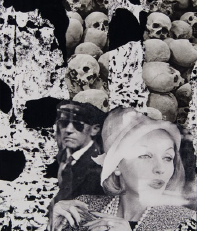
Death row, 2009
Éditions photographiques
et encre de chine sur papier cartonné
26 x 30 cm
entre les images et le volume s’opère par le mouvement même du
spectateur. La photo oblige à choisir un point de vue. (…)
De même que la peinture s’inscrit dans une continuité, l’usage des
éditions photographiques renvoie à une recherche d’un passé proche,
déjà obsolète mais encore actif. (…)
Tous ces livres de voyages, documentaires, sur les animaux, les
paysages, les monuments etc… évoquent un monde qui a disparu.
Ce sont les traces d’une exploration lente et méthodique d’avant la
perception simultanément «mondialiste» d’aujourd’hui. (…)
Face à la puissance de fascination de l’image en mouvement, l’image
fixe, possède une capacité à résumer, à condenser et peut-être à
produire une icône. (…)
Au moment où la couleur semble pouvoir à nouveau s’intégrer dans
cette évolution, il m’a paru opportun de faire une pause et de donner à
voir ces «objets» qui ne sont ni des peintures, ni des sculptures, ni des
collages au sens habituel du terme, et de rechercher ensemble quel
sens leur donner. (…)
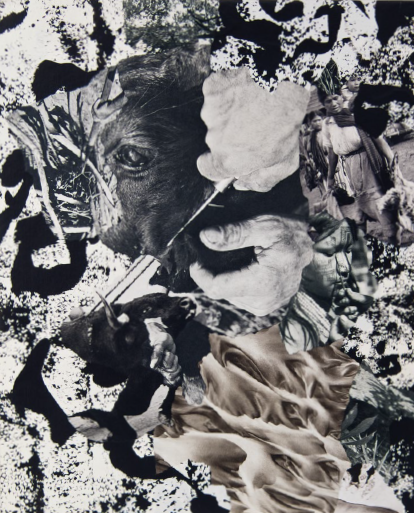
Éloge de la cruauté, 2006
Éditions photographiques
et encre de chine sur carton
23 x 24 cm
Ghislaine Glasson Deschaumes
L’interpellation des Images-monde de Pierre Zarcate
sonne comme un manifeste rappelant à qui veut
l’entendre que le monde est réseaux et qu’il n’existe
plus depuis longtemps un seul monde ni de monde en
propre. De loin, les fragments qui scandent la surface
sensiblement lisse et soyeuse paraissent offrir aux lignes
qui les délimitent l’extraordinaire opportunité de faire
trame. Ce plan trouble par l’appât mystérieux qu’il met
en oeuvre sans paraître y toucher, mi-offrande à nos
mémoires, mi-reliquaire de celles-ci. Il appelle. Il faut
alors avancer de plusieurs pas, se laisser tirer vers un
divers qui, se livrant dans une prolifération apparente,
est le rigoureux agencement de l’exacte et puissante
multitude.
Mais quelle prise choisir pour s’aventurer sur les étranges
parois des Images-monde dont les aspérités propres au
collage (la déchirure de la photo, l’épaisseur des morceaux
enchevêtrés, le léger paquet de colle sous un coin) sont
stratégiquement gommées, jusqu’à disparaître sous le fin
pelliculage qui recouvre uniformément l’oeuvre, créant
l’illusion troublante de l’immatérialité ? Par quelle voie
s’engager pour que les interstices servent d’appui au
cheminement du regard ? Zarcate nous rappelle que
regarder est une quête physique et un exercice spirituel.
Il faut chercher et se chercher devant une image-monde.
Parfois, comme dans le Grand Nord, le centre se laisse
immédiatement percevoir, ordonnant la circulation du
regard et la perception des rythmes autour du pôle qu’il
constitue. A d’autres moments, comme dans Haut en
Couleur c’est une zone excentrée qui oriente le regard
par sa zone de densité propre et le guide à partir d’elle
à travers les strates de l’ensemble de l’oeuvre. Et, lorsque
des fragments de dessin à l’encre ou de lavis réalisés
par l’artiste viennent faire interstice entre les morceaux
photographiques, d’une manière presque toujours
impalpable et quasi indécelable, l’oeil se déplace selon le
rythme de ces lignes de faille.
Il arrive encore que le regard plonge en apnée ; il s’emballe
alors dans le rythme fragmenté dont Pierre Zarcate
dit volontiers qu’il a à faire avec le rap, ses narrations
scandées, les gestes du hip hop, voire son épopée.
Il faut prendre du temps et prendre le goût du lâcher
prise, d’accueillir d’autres repères plus enfouis. La
collecte des matériaux prélude à l’exposition minutieuse
des fragments photographiques sur le sol puis à leur 2005), là des motifs de pelage et de peaux de mammifères
entre des visages (Black and Wild – 2007) , ailleurs
encore des motifs d’oiseaux chatoyants entre les mollets
des coureurs du Tour de France (Haut en couleur – 2007)
ou bien incluant, dans une radicale mise à distance du
parti pris du matériau photographique, des parcelles de
dessin.
On s’appesantit à déchiffrer la mosaïque des parcelles
de nos mémoires collectives mondialisées qui sont ainsi
puissamment ramenées vers le format contraignant et
immuable du carré d’un mètre par un mètre. Les détails
que l’oeil saisit en s’approchant sans réserve sont d’un
soin détaillé et coloré. Certains, dans le jeu subtil auquel
se livre l’artiste en introduisant parcimonieusement
la couleur au coeur des noirs, des gris et des blancs,
sont comme des miniatures persanes. La plongée est
vertigineuse. Agencés sans trace d’agencement, dans
un geste illusionniste, les fragments sont liés entre
eux dans une rigueur extrême. On attendrait l’accroc
du chevauchement des surfaces, de l’inadéquation
d’un rapprochement, d’un froissement inopiné.
Mais d’évidence, la surface est étonnament lisse et brillante,
le plan se veut sans aspérité. Ainsi se développe le
rythme des réseaux que composent les pans d’images
livrés en excès et les traits d’un noir dense qui les relient.
Le regard s’appuie à ces rets. Nous sommes dans des
mondes-réseaux.
Jouant sur la multitude, chaque image-monde de Pierre
Zarcate est une et singulière, sous sa familiarité ambiguë
où l’intime le dispute à la sphère publique. Travaillant
avec des images connues/reconnues (les icônes de notre
temps) ou au contraire longtemps recelées dans les
secrets de quelques tiroirs, l’image-monde se livre à
la fois comme un manifeste public au coeur de la cité
et un monologue archéologique intime. On cherche,
inconsciemment d’abord, puis obsessionnellement
ensuite, l’épicentre du monde (un dans la multitude) ainsi
télescopé. On refait surface tel le nageur essoufflé. On y
retourne ensuite assemblage patient par l’artiste sur le plan, ou le
volume, adopté comme support. Elle se fait dans les
livres de photographies chinés au hasard des marchés,
« recyclant », dit Pierre Zarcate des matériaux d’une
« période de l’imprimerie où les reproductions étaient
encore imprimées en héliogravure ». Elle puise dans
la mémoire collective mondiale et fait surgir ce que
Roland Barthes appelait les mythologies d’une époque,
de la « Grande guerre » (Historic – 2002) aux scènes
archétypiques de crimes à la Woyzeck, de l’épopée des
Kennedy à celle du monde industriel hérité du XIXème
siècle, de l’épopée exploratoire du Grand Nord à celle de
la tauromachie, de l’épopée des mondes urbains à celle de
leurs figures emblématiques (le hip hop encore).
Mue par la subjectivité de l’artiste, la collecte, et sa
traduction dans l’assemblage, plonge dans l’inconscient
collectif, sa relation aux grands fondamentaux de
l’humain, ses rapports mystérieux au monde animal (et
ce dernier surgit dans sa radical étrangeté, sans tentative
de domestication). Elle remâche la « part maudite » de
l’humain (Blanchot), la part animale du monde et de la
terre, la part architecturale de la présence humaine.
La démarche est archéologique et anthropologique,
géologique ou architecturale, elle lit le temps et l’espace
comme des strates ou des pièces de mosaïque éparses.
On l’imagine lente. Elle est une quête et une enquête
obsédées-obsédantes jusque dans la composition. Elle
oriente Pierre Zarcate vers l’élaboration d’une narration
qui se joue des icônes de notre monde pour capter une
épopée de l’humain qui ne se laisse pas résumer aux
séquences temporelles des matériaux choisis et fixer
certaines de ses composantes héroïques dans des
éléments qui confinent au reliquaire.
L’assemblage, ensuite, emprunte au hasard de l’aventure
fractale sans pour autant jamais laisser penser qu’il a tout
cédé à l’aléatoire. La collecte ouvre vers la composition
d’une image-monde qui garderait du kaléidoscope
sa dimension mosaïque et sa sophistication, mais en
abandonnerait le caractère géométrique et mécanique
pour donner libre cours à l’impulsion et à la vivacité du
geste de collage.
La composition est serrée à l’extrême. Elle semble à
ce point une expérience limite que l’artiste prend le
parti d’ouvrir l’oeuvre de l’intérieur, insérant ici des
motifs végétaux devenant saxifrages dans la paroi des
fragments d’archive de la police criminelle (Dramatic –
Les Images Monde
Emmanuel Brassat
Il fut un temps où la peinture se devait de raconter une
histoire, d’être une enquête sur le monde, de donner
à voir quelque scène visible du réel au moyen de la
circonscription des lieux, de la composition des surfaces,
de la réception des lumières, comme l’écrivit Alberti
en 1435. Elle perdit cette fonction quand cessa dans la
culture européenne la croyance aux images peintes
comme à des représentations exhaustives du monde.
La peinture se fit abstraite, cessa d’être représentative.
Elle devint critique d’elle-même, organisant sa propre
déconstruction par la dissociation des plans, des volumes,
des surfaces, des couleurs, des contours, des référents, des
supports pour atteindre le point de crise conjoint d’une
suspension du visible et d’une saturation des formes
picturales. Ce faisant, le monde où nous vivions cessait
peu à peu, lui aussi, de nous paraître éminemment
visible, de faire histoire. Non point qu’il n’y ait plus en
lui d’images possibles – au contraire les appareils et
les technologies de l’image vinrent en répandre l’usage
universalisé – mais au point de nous en inonder, de nous
rendre la réalité hyper distincte et tout autant indistincte
et confuse.
Comme s’il voulait aller à l’encontre de cela, Pierre Zarcate
est un peintre qui collecte des multitudes d’images
photographiques dans des livres anciens qu’il déchire et
fragmente, puis colle pour en faire des tableaux, posant
de la sorte de nouvelles perspectives picturales sur le
monde. Des hyper-tableaux pourrait-on dire, presque
ceux d’un démiurge tant la tâche en sa réalisation pourra
paraître ample. Le geste du peintre est ici celui de prélever
et de détacher, de séparer, puis de choisir pour composer,
réunir, assembler. Chacun de ces fragments représente
dans le travail d’assemblage autant de traits, de couleurs,
de taches, d’éléments formels, cela indépendamment
de leur valeur propre initiale de morceaux d’images.
De tels tableaux, Pierre Zarcate les appelle des Imagesmonde.
Chacune de celles-ci s’ordonne autour d’un thème
précis et de ses matériaux d’images et/ou d’Histoire :
le hip hop, les fleurs, les Kennedy, la vie aquatique, les
guerres du XXe siècle, le corps féminin, le Grand Nord,
la violence, les chevaux, les minéraux, les villes, le Japon,
les reliefs du paysage etc. Ce sont là autant de scènes de
la vie humaine, végétale, animale, d’aspects du monde,
de motifs picturaux qui furent autrefois déjà thèmes de
peinture. Pour donner à ces ensembles leur unité, Pierre
Zarcate déchire aussi des calligraphies abstraites, faites
par lui au lavis, pour disposer d’éléments qui viennent
se disposer entre eux. Quand les tableaux sont en noir et
blanc, ces éléments adjoints apparaissent comme autant
de traits contrastés dont la puissance abstraite donne à
l’ensemble sa valeur picturale. De sorte que l’abstraction
vient ici pour tenir la figuration et la transfigurer en
abstraction. Les mêmes effets de jointure et de trame sont
travaillés au pinceau pour les tableaux de couleur afin de
produire un effet similaire.
Ces tableaux faits de collages sont assemblés sur
des panneaux de bois auxquels ont été données
différentes conformités. Surfaces planes, concaves,
ondulées, convexes, plissées, elles tendent toutes à être
tridimensionnelles. Le support du tableau est souvent
un caisson de forme complexe, par exemple des volumes
géométriques aplanis, des cavités affaissées, des plans
déformés et juxtaposés. de sorte que les tableaux
composés ne sont pas posés sur des surfaces planes et
que l’on ne sait jamais exactement si l’on est face à des
images bidimensionnelles ou à des objets et des univers
de dimension spatiale, déformés et conformés par le
travail des volumes. Ainsi les images-monde s’enroulent
et se déploient sur ces objets, se pouvant regarder sur
leurs différents côtés, ou, à l’inverse, se voient propulsées,
projetées dans une réalité tridimensionnelle qui les
enlève à leur apparente simplicité.
Par un tel travail, Pierre Zarcate nous invite à interroger
encore les limites de la représentation figurative, cela
après son dessaisissement par l’abstraction et son
immersion dans l’image matérielle des appareils.
Tout autant, il tente de ressaisir les conditions de
l’art pictural comme relation physique à la tension
matérielle et abstraite sous jacente des images, fidèle
en cela à l’expressionnisme abstrait. Des images qui
apparaissent chez lui comme celles d’un monde pluralisé,
à la matérialité dispersée, saturée, sans circonscription
possible et défigurées. Pourtant, a contrario, de telles
images seraient encore localisables, dans une forme
donnée par l’art du peintre après la peinture, sous
la contrainte de leur trame spatiale, non figurative,
objective, celle de l’image fragmentée et recomposée.
Celle des Images-monde.